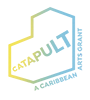Catapult – Résidence d’artiste à la maison – visites virtuelles d’atelier
SOURCE: Madinin-art
28 Jan, 2021
Camille Chedda, des ruines en construction
— Par Matilde dos Santos, Historienne, critique d’art et curateur indépendant —
En aout dernier Fresh Milk (Barbade) et Kingston Creative (Jamaïque) avec l’appui de l’American Friends of Jamaica (États-Unis), ont lancé CATAPULT | A Caribbean Art Grant. Ce programme, à travers six différentes initiatives, a fourni directement, pendant cinq mois, un soutien financier à plus de 1000 artistes et entrepreneurs créatifs de la Caraïbe touchés par la pandémie. Une de ces initiatives était la résidence d’artiste à la maison (Stay Home Artist Residency – SHAR). Vingt-quatre artistes ont été sélectionnés et les résidences ont été échelonnées en trois groupes du 21 septembre au 11 décembre. J’ai eu la chance de faire partie des curateurs-visitant et suis heureuse de partager avec vous ces rencontres virtuelles. Chaque rencontre m’a apporté quelque chose de différent ; chacun de ces artistes m’a émue à sa manière. J’étais particulièrement heureuse de faire la connaissance de Camille Chedda, dont je connaissais le travail uniquement par photo.
Camille Chedda (Manchester, Jamaïque, 1985 ) vit et travaille en Jamaïque. Elle est diplômée d’arts visuels par l’Edna Manley College, et titulaire d’un Master de beaux-arts par l’Université du Massachusetts à Dartmouth. Sa pratique est polymorphe et questionne l’identité post-coloniale. En utilisant des matériaux de la vie de tous les jours elle traque la décomposition emboutie dans toute construction notamment dans cette construction jamais finie : l’identité ; son identité personnelle qui se confond avec une possible identité caribéenne. Ses œuvres ont été exposées à la National Gallery of Jamaica, au Museum of Latin American Art, au Portland Museum of Art, à la Wallach Art Gallery de l’Université de Colombie, entre autres. Récipiendaire de nombreux prix dont le prix Albert Huie, la bourse de la Fondation Reed, le premier prix commémoratif Dawn Scott et le prix du programme TAARE du British Council, elle a également été artiste en résidence à Alice Yard à Trinidad et Tobago, à Art Omi à New York et à Hospitalfield en Écosse. Enseignante au l’Edna Manley College, elle a assumé en 2016 la tête du projet artistique et social InPulse Collective, financé par Rubis Mecenat afin de soutenir les jeunes artistes de Jamaïque.
Je connaissais les travaux de peinture de Camille sur des sacs en plastique, comme Shelf Lives (2011) où elle peignait à l’acrylique toute une série de petits portraits de gens ordinaires sur des sacs transparents. Les portraits sur sacs jetables produisaient la dérangeante sensation de vies également jetables, rendant d’une façon simple et percutante le peu de valeur que la vie des populations les plus précaires peut avoir. J’ai quitté le Brésil il y a longtemps mais le Brésil ne m’a jamais quitté et tout ce que je vis me renvoie à mon pays. C’est pour cela sans doute que ces personnages rendus en quelques traits simples, prêts à être utilisés et remplacés, résonnaient si douloureusement en moi. Sur ce même support l’artiste a créé Wholesale dégradables, série de portraits de personnes tuées par la police à Kingstown, retirées des statistiques officielles et dessinées d’après photos. Certains personnages, pour lesquels l’artiste n’avait pas réussi à trouver des photos, étaient remplacés par d’autres actes de violence, pas forcément actuels, ou jamaïcains. L’artiste établissait ainsi le lien entre la violence actuelle quotidienne et la brutalité systémique de l’histoire coloniale. Et là aussi je ne peux pas m’empêcher de reconnaître la bestialité policière récurrente comme un produit d’une histoire coloniale qui se perpétue. L’idée d’une population disponible et jetable est accentuée par l’évanescence des portraits évoquée dans Built-In obsolescence. La peinture acrylique sur le plastique peut s’émietter et ce rendu lui permettait de jouer avec le temps, notamment avec la notion de date d’expiration.

Un autre matériau très présent dans ses œuvres, est celui qu’elle va utiliser pour l’œuvre développée durant la résidence CATAPULT : le parpaing ou bloc de concret creux. Ils apparaissent sur des dessins au charbon de la série Drop it low de 2016 renvoyant à des vidéos qui ont viralisé en Jamaïque en 2015 et sur lesquelles des femmes couchées sur le dos par terre lors soirées dancehall dans les rues, cassaient des blocs de ciment sur leurs entrejambes. Le dancehall est souvent présenté comme un espace de liberté pour les femmes, mais ces vidéos montraient surtout une sorte de simulation de sexe violent, pendant lequel des femmes se faisaient payer des petites sommes par le public pour démontrer leurs talents de casseuses de concret, talents qui menaient sans doute à des problèmes de santé graves. Critiquer le dance hall en tant que femme noire en Jamaïque n’est pas une position confortable, mais c’est celle que Camille a prise en montrant des dessins où une femme s’autodétruit pour le plaisir des autres. Et quand on parle d’autodestruction de corps noirs, on peut être sûr que la colonie n’est pas bien loin. Les parpaings étaient présents également dans l’installation, Rebuild montrée à la Ghetto biennale 2017 en Haïti. La pièce renvoyait à la destruction de la ville de Port au Prince en 2010, et à sa reconstruction éternellement en cours, mais aussi à la fragilité des blocs de ciment censés être résistants, mais fragilisés par la cupidité des fabricants qui mettent sur le marché des blocs en deçà des normes. Ces contrefaçons pourraient d’ailleurs être impliquées dans la destruction qu’on a pu voir en Haïti lors du séisme de 2010. Le matériau l’accompagne donc depuis 2016, et récemment j’ai pu voir sur le net ses photos des corps fragmentés noyés dans une mer de sable et de parpaing. J’aime beaucoup l’idée de construction-déconstruction et le lien que l’artiste fait avec le corps (et quelque part l’âme, ce qu’elle ne dit pas mais aurait pu dire).

Camille a choisi pour la résidence CATAPULT de travailler sur un empilement de parpaings, une œuvre que je découvre à ses débuts, et qu’elle va développer finalement assez vite, pour une première exposition collective « …and I resumed the struggle » à l’Olympia Gallery, de Kinsgton, à partir du 10 décembre. L’œuvre dans son état actuel a été entièrement réalisée dans le cadre de la résidence CATAPULT avec le support également de WARE (The Wattle and Red Earth). Au moment de la visite, la pièce était encore très embryonnaire et son état actuel n’est toujours pas définitif.

Dans cette pièce, Camille a voulu soumettre la notion de patrimoine à la pensée décoloniale. L’artiste voit le patrimoine comme une sorte d’édifice, une gangue exogène totalement orientée vers le tourisme et qui ne tient pas compte (« n‘honore pas ») la population noire, qui est la majorité de la population de Jamaïque
La genèse de la pièce remonte à 2019, mais la réalisation a débuté en octobre dernier. Cette pièce est à relier à The Three disgraces, un collage de 2019, montrant un mur à la fois chevauché et oblitérant trois danseuses de dancehall, encerclées par des images d’argent, du public et d’enfants. Ces enfants seraient exposés selon l’artiste à quelque chose qui est présenté comme leur culture et part de leur patrimoine. C’est en partant des idées du mur et du patrimoine que Camille a commencé à penser à sa nouvelle pièce. Elle renvoie à la construction sociale de l’identité. Les parpaings sont empilés en mur et les ouvertures de chaque brique de concret sont occupées soit par des tablettes avec des vidéos, soit par des photos ou des objets… Quand on regarde de loin on a l’impression de regarder des appartements d’une tour depuis l’extérieur. Cela évoque à la fois construction et cloisonnement, fondation et emmurement. L’aspect brut et l’assemblage non finis suggèrent une construction, les petites cases occupées et les défauts visibles rappellent une ruine. Cela m’a fait penser à la jolie chanson de Caetano Veloso : « Ici tout semble être encore en construction mais c’est déjà une ruine. » Caetano parlait de Rio de Janeiro, mais c’est bien de cela dont parle Camille. Des ruines en construction. Une construction qui se délite dans le processus de construction lui-même. Plus qu’une obsolescence programmée, une sorte de dénaturalisation ; où ce qui fonde ruine, ce qui érige, démolit, ce qui élève, abat….


Lors de notre entretien Camille souhaitait figurer la mer en haut du mur, se ravisait et pensait peut-être à occuper la partie haute par des photos de bâtiments patrimoniaux, notamment Rose Hall, une ancienne Maison de maître datant de la première moitié du XVIII siècle. Très imposante, la maison en style géorgien a été abandonnée, est tombée en ruines dans les années 1960, puis a été rénovée vers la fin des années 70 par des Américains qui en ont fait un musée. Ce musée montre une histoire de la plantation et la légende de la sorcière blanche de Rose Hall, une fiction. Et c’est ce caractère fictionnel, qui romantise le patrimoine colonial que Camille voudrait questionner. Construite pendant la pandémie la pièce a évolué pour donner de plus en plus de place aux écrans, qui avec la pandémie sont devenus quasiment le seul moyen de socialisation de la population confinée. Sur le thème de la construction sociale et mémorielle, la pièce m’a fait penser à l’installation sculpturale de Cildo Meireles, Babel (2001). L’installation monumentale (plus de 9 mètres de haut) est composée d‘un empilement de 800 postes radios, de différentes marques et époques branchés sur des canaux différents a des niveaux sonores distincts, faiblement audibles. Autour de la pièce une pénombre bleutée immergeait le public dans le brouhaha sonore des langues du monde entier. Je pensais aussi, pour l’avoir vu récemment dans un autre programme CATAPULT, le salon du confinement, à la pièce Grand Crus, appellations contrôlées le retour de Viktor Sainsilly Cayol, elle aussi une construction, à base de matériaux qui bâtissent la mémoire. L’œuvre de Richard-Viktor Sainsily Cayol a deux versions, les deux formées par des fûts de chêne organisés en pyramide placés sur un socle triangulaire dans une lumière bleue. La première version (Biennale de Dakar, 2014) présentait des fûts marqués compagnie des indes sur lesquels sont gravés également divers noms d’ethnies. Dans la deuxième version (Biennale de la Havane, 2019), les fûts non marqués sont hérissés de piquants.


CRITIQUES D’ART
Catapult – Résidence d’artiste à la maison – visites virtuelles d’atelier
11 décembre 2020
Camille Chedda, des ruines en construction

— Par Matilde dos Santos, Historienne, critique d’art et curateur indépendant —
Photo 1 Camille Chedda, Untitled, 2020 vue de l’installation terminée dans l’atelier (détail). Photo @Charles Allen. Courtoisie de l’artiste.
En aout dernier Fresh Milk (Barbade) et Kingston Creative (Jamaïque) avec l’appui de l’American Friends of Jamaica (États-Unis), ont lancé CATAPULT | A Caribbean Art Grant. Ce programme, à travers six différentes initiatives, a fourni directement, pendant cinq mois, un soutien financier à plus de 1000 artistes et entrepreneurs créatifs de la Caraïbe touchés par la pandémie. Une de ces initiatives était la résidence d’artiste à la maison (Stay Home Artist Residency – SHAR). Vingt-quatre artistes ont été sélectionnés et les résidences ont été échelonnées en trois groupes du 21 septembre au 11 décembre. J’ai eu la chance de faire partie des curateurs-visitant et suis heureuse de partager avec vous ces rencontres virtuelles. Chaque rencontre m’a apporté quelque chose de différent ; chacun de ces artistes m’a émue à sa manière. J’étais particulièrement heureuse de faire la connaissance de Camille Chedda, dont je connaissais le travail uniquement par photo.
Camille Chedda (Manchester, Jamaïque, 1985 ) vit et travaille en Jamaïque. Elle est diplômée d’arts visuels par l’Edna Manley College, et titulaire d’un Master de beaux-arts par l’Université du Massachusetts à Dartmouth. Sa pratique est polymorphe et questionne l’identité post-coloniale. En utilisant des matériaux de la vie de tous les jours elle traque la décomposition emboutie dans toute construction notamment dans cette construction jamais finie : l’identité ; son identité personnelle qui se confond avec une possible identité caribéenne. Ses œuvres ont été exposées à la National Gallery of Jamaica, au Museum of Latin American Art, au Portland Museum of Art, à la Wallach Art Gallery de l’Université de Colombie, entre autres. Récipiendaire de nombreux prix dont le prix Albert Huie, la bourse de la Fondation Reed, le premier prix commémoratif Dawn Scott et le prix du programme TAARE du British Council, elle a également été artiste en résidence à Alice Yard à Trinidad et Tobago, à Art Omi à New York et à Hospitalfield en Écosse. Enseignante au l’Edna Manley College, elle a assumé en 2016 la tête du projet artistique et social InPulse Collective, financé par Rubis Mecenat afin de soutenir les jeunes artistes de Jamaïque.
Je connaissais les travaux de peinture de Camille sur des sacs en plastique, comme Shelf Lives (2011) où elle peignait à l’acrylique toute une série de petits portraits de gens ordinaires sur des sacs transparents. Les portraits sur sacs jetables produisaient la dérangeante sensation de vies également jetables, rendant d’une façon simple et percutante le peu de valeur que la vie des populations les plus précaires peut avoir. J’ai quitté le Brésil il y a longtemps mais le Brésil ne m’a jamais quitté et tout ce que je vis me renvoie à mon pays. C’est pour cela sans doute que ces personnages rendus en quelques traits simples, prêts à être utilisés et remplacés, résonnaient si douloureusement en moi. Sur ce même support l’artiste a créé Wholesale dégradables, série de portraits de personnes tuées par la police à Kingstown, retirées des statistiques officielles et dessinées d’après photos. Certains personnages, pour lesquels l’artiste n’avait pas réussi à trouver des photos, étaient remplacés par d’autres actes de violence, pas forcément actuels, ou jamaïcains. L’artiste établissait ainsi le lien entre la violence actuelle quotidienne et la brutalité systémique de l’histoire coloniale. Et là aussi je ne peux pas m’empêcher de reconnaître la bestialité policière récurrente comme un produit d’une histoire coloniale qui se perpétue. L’idée d’une population disponible et jetable est accentuée par l’évanescence des portraits évoquée dans Built-In obsolescence. La peinture acrylique sur le plastique peut s’émietter et ce rendu lui permettait de jouer avec le temps, notamment avec la notion de date d’expiration.

Photo 2 Camille Chedda, Untitled (Built-in Obsolescence series, 2011-12), mixed media, sur sac en plastique. Photo web.
Un autre matériau très présent dans ses œuvres, est celui qu’elle va utiliser pour l’œuvre développée durant la résidence CATAPULT : le parpaing ou bloc de concret creux. Ils apparaissent sur des dessins au charbon de la série Drop it low de 2016 renvoyant à des vidéos qui ont viralisé en Jamaïque en 2015 et sur lesquelles des femmes couchées sur le dos par terre lors soirées dancehall dans les rues, cassaient des blocs de ciment sur leurs entrejambes. Le dancehall est souvent présenté comme un espace de liberté pour les femmes, mais ces vidéos montraient surtout une sorte de simulation de sexe violent, pendant lequel des femmes se faisaient payer des petites sommes par le public pour démontrer leurs talents de casseuses de concret, talents qui menaient sans doute à des problèmes de santé graves. Critiquer le dance hall en tant que femme noire en Jamaïque n’est pas une position confortable, mais c’est celle que Camille a prise en montrant des dessins où une femme s’autodétruit pour le plaisir des autres. Et quand on parle d’autodestruction de corps noirs, on peut être sûr que la colonie n’est pas bien loin. Les parpaings étaient présents également dans l’installation, Rebuild montrée à la Ghetto biennale 2017 en Haïti. La pièce renvoyait à la destruction de la ville de Port au Prince en 2010, et à sa reconstruction éternellement en cours, mais aussi à la fragilité des blocs de ciment censés être résistants, mais fragilisés par la cupidité des fabricants qui mettent sur le marché des blocs en deçà des normes. Ces contrefaçons pourraient d’ailleurs être impliquées dans la destruction qu’on a pu voir en Haïti lors du séisme de 2010. Le matériau l’accompagne donc depuis 2016, et récemment j’ai pu voir sur le net ses photos des corps fragmentés noyés dans une mer de sable et de parpaing. J’aime beaucoup l’idée de construction-déconstruction et le lien que l’artiste fait avec le corps (et quelque part l’âme, ce qu’elle ne dit pas mais aurait pu dire).

Photo 3 Camille Chedda, Drop it Low at famous Wednesday, 2016. Dessin, charbon sur papier. Photo web
Camille a choisi pour la résidence CATAPULT de travailler sur un empilement de parpaings, une œuvre que je découvre à ses débuts, et qu’elle va développer finalement assez vite, pour une première exposition collective « …and I resumed the struggle » à l’Olympia Gallery, de Kinsgton, à partir du 10 décembre. L’œuvre dans son état actuel a été entièrement réalisée dans le cadre de la résidence CATAPULT avec le support également de WARE (The Wattle and Red Earth). Au moment de la visite, la pièce était encore très embryonnaire et son état actuel n’est toujours pas définitif.

Photo 4 Camille Chedda, work in progress. Capture d’écran.
Dans cette pièce, Camille a voulu soumettre la notion de patrimoine à la pensée décoloniale. L’artiste voit le patrimoine comme une sorte d’édifice, une gangue exogène totalement orientée vers le tourisme et qui ne tient pas compte (« n‘honore pas ») la population noire, qui est la majorité de la population de Jamaïque
La genèse de la pièce remonte à 2019, mais la réalisation a débuté en octobre dernier. Cette pièce est à relier à The Three disgraces, un collage de 2019, montrant un mur à la fois chevauché et oblitérant trois danseuses de dancehall, encerclées par des images d’argent, du public et d’enfants. Ces enfants seraient exposés selon l’artiste à quelque chose qui est présenté comme leur culture et part de leur patrimoine. C’est en partant des idées du mur et du patrimoine que Camille a commencé à penser à sa nouvelle pièce. Elle renvoie à la construction sociale de l’identité. Les parpaings sont empilés en mur et les ouvertures de chaque brique de concret sont occupées soit par des tablettes avec des vidéos, soit par des photos ou des objets… Quand on regarde de loin on a l’impression de regarder des appartements d’une tour depuis l’extérieur. Cela évoque à la fois construction et cloisonnement, fondation et emmurement. L’aspect brut et l’assemblage non finis suggèrent une construction, les petites cases occupées et les défauts visibles rappellent une ruine. Cela m’a fait penser à la jolie chanson de Caetano Veloso : « Ici tout semble être encore en construction mais c’est déjà une ruine. » Caetano parlait de Rio de Janeiro, mais c’est bien de cela dont parle Camille. Des ruines en construction. Une construction qui se délite dans le processus de construction lui-même. Plus qu’une obsolescence programmée, une sorte de dénaturalisation ; où ce qui fonde ruine, ce qui érige, démolit, ce qui élève, abat….


Photo 5 et 6 Camille Chedda, Untitled, 2020, détail. Capture d’écran.
Lors de notre entretien Camille souhaitait figurer la mer en haut du mur, se ravisait et pensait peut-être à occuper la partie haute par des photos de bâtiments patrimoniaux, notamment Rose Hall, une ancienne Maison de maître datant de la première moitié du XVIII siècle. Très imposante, la maison en style géorgien a été abandonnée, est tombée en ruines dans les années 1960, puis a été rénovée vers la fin des années 70 par des Américains qui en ont fait un musée. Ce musée montre une histoire de la plantation et la légende de la sorcière blanche de Rose Hall, une fiction. Et c’est ce caractère fictionnel, qui romantise le patrimoine colonial que Camille voudrait questionner. Construite pendant la pandémie la pièce a évolué pour donner de plus en plus de place aux écrans, qui avec la pandémie sont devenus quasiment le seul moyen de socialisation de la population confinée. Sur le thème de la construction sociale et mémorielle, la pièce m’a fait penser à l’installation sculpturale de Cildo Meireles, Babel (2001). L’installation monumentale (plus de 9 mètres de haut) est composée d‘un empilement de 800 postes radios, de différentes marques et époques branchés sur des canaux différents a des niveaux sonores distincts, faiblement audibles. Autour de la pièce une pénombre bleutée immergeait le public dans le brouhaha sonore des langues du monde entier. Je pensais aussi, pour l’avoir vu récemment dans un autre programme CATAPULT, le salon du confinement, à la pièce Grand Crus, appellations contrôlées le retour de Viktor Sainsilly Cayol, elle aussi une construction, à base de matériaux qui bâtissent la mémoire. L’œuvre de Richard-Viktor Sainsily Cayol a deux versions, les deux formées par des fûts de chêne organisés en pyramide placés sur un socle triangulaire dans une lumière bleue. La première version (Biennale de Dakar, 2014) présentait des fûts marqués compagnie des indes sur lesquels sont gravés également divers noms d’ethnies. Dans la deuxième version (Biennale de la Havane, 2019), les fûts non marqués sont hérissés de piquants.

Photo 7. Camille Chedda, Untitled, Installation, blocs de concret, tablettes avec vidéo, photos, objets, …. Vue d’installation dans la Galerie Olympe, Kingston, 10 décembre 2020. Photo Veerle Poupeye.

Photo 1 Camille Chedda, Untitled, 2020 vue de l’installation terminée dans l’atelier . Photo @Charles Allen. Courtoisie de l’artiste.
Parce que la mémoire est une construction, parfois avec des parpaings de mauvaise qualité, Camille m’a fait penser au Cahier d’un retour au pays natal, à ceux qui n’ont rien inventé ou dompté. Nous ne sommes peut-être pas des bâtisseurs de cathédrales*, mais nous bâtissons quand même.
Matilde dos Santos
Historienne, critique d’art et curateur indépendant
Remerciements à The American Friends of Jamaica, Kingston Creative et Fresh Milk.
Blog des artistes en résidence, y compris Camille, sur la plateforme Fresh Milk : https://freshmilkbarbados.com/2020/11/10/catapult-stay-home-artist-residency-blogs-issue-2-vol-1-2/
Site de l’artiste Camille Chedda : https://www.camillechedda.com/
Sur l’œuvre Babel de Cildo Meirelles : https://www.tate.org.uk/art/artworks/meireles-babel-t14041
Sur Grands Crus versions 1 et 2 voir le site de l’artiste : https://sainsily-cayol.com/
Aimé Césaire, Cahier d’un retour au pays natal, 1956 © Seuil, 2006.
*Nous ne sommes pas des bâtisseurs de cathédrales est le titre d’une œuvre de l’artiste martiniquaise Jacqueline Fabien